"Le plagiat à l’ère de l’IA: une accusation sans fondement ?"
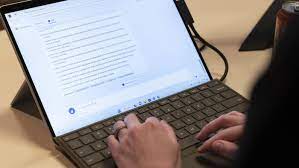
Par Mahjoub Lotfi Belhedi
Chercheur en réflexion stratégique et digitale // CEO d'un cabinet spécialisé en transformation IA // Certifié « Data Scientist » auprès d'une université américaine & ex-directeur de département « Cybersécurité » du "Centre Tunisien pour les Études de la Sécurité Globale"
L’émergence des IA génératives, à l’instar du duo redoutable ChatGPT/Deepseek, soulève des interrogations profondes quant à la pertinence et à l’actualité de la notion de plagiat. Autrefois conçue pour désigner la reproduction non autorisée ou dissimulée d’œuvres intellectuelles humaines, cette notion se trouve aujourd’hui confrontée à des réalités technologiques inédites qui en bouleversent les fondements. Il devient impératif de réinterroger notre rapport à la production de contenu dans un univers professionnel et universitaire de plus en plus soupçonné de plagiat.
Un modèle comme ChatGPT, bien qu’il ne reproduise pas mot à mot des textes préexistants, génère du contenu à partir d’une modélisation statistique du langage, apprise sur des corpus variés. Il s’agit donc d’une forme de reformulation algorithmique issue des différents canaux informationnels.
Or, cette dynamique d’apprentissage par ingestion massive de textes disponibles sur le web et dans des bases de données est souvent brandie comme une preuve indirecte de plagiat. Pourtant, l’IA ne revendique ni droit d’auteur, ni paternité sur les textes produits. Elle ne fait qu’optimiser, à la demande de l’utilisateur, une forme langagière répondant à des instructions spécifiques.
Dans cette configuration, s’il devait y avoir infraction, il faudrait alors incriminer non pas l’utilisateur, mais le dispositif lui-même – ce qui revient à poser une question bien plus vaste, d’ordre philosophique et juridique : celle de la responsabilité dans les productions automatisées générées par les chatbots d’IA.
À cela s’ajoute un problème majeur : la remise en question croissante de la crédibilité des logiciels de détection de plagiat adaptés à l’IA. Nombre d’entre eux reposent sur des critères de similarité lexicale ou syntaxique, inadaptés aux contenus générés de manière probabiliste. Certains outils accusent à tort des textes d’être plagiés ou générés par IA en raison de leur "trop grande fluidité" ou de leur "manque d’erreurs humaines", ce qui révèle une conception biaisée de l’authenticité. Ces diagnostics hasardeux participent à une forme de suspicion généralisée, qui décrédibilise autant le pseudo-outil de détection que l’utilisateur.
Plus fondamentalement, parler de plagiat dans un monde où la frontière entre humain et machine s’estompe chaque jour davantage relève d’une absurdité conceptuelle.
Dans un écosystème où les individus dépendent de plus en plus d’outils d’aide à la rédaction, de correction automatique, d’optimisation lexicale et de reformulation assistée, peut-on encore distinguer nettement ce qui est "proprement humain" ? Et à supposer que l’on puisse encore le faire, à quoi bon maintenir une accusation de plagiat dans un contexte où la contribution humaine devient marginale face à la puissance algorithmique des modèles IA ?
De surcroît, l’accusation de plagiat appliquée aux productions issues d’IA générative relève davantage d’une réaction de panique face à cette transformation profonde et irréversible du paradigme linguistique et d'une auto-flagellation intellectuelle hypocrite d'une bonne partie d'universitaire à travers le monde...
En conclusion, une chose est sûre : parler de plagiat dans un tel contexte semble presque dérisoire. Car l’IA ne plagie pas. Elle dépasse, elle remplace, elle avale. Et dans son sillage, elle laisse l’écho mélancolique d’une humanité qui, en cherchant à se surpasser, est en train de perdre inévitablement son territoire identitaire…
Alors, il est temps d’arrêter cette stérile matsurbation d’esprit : elle ne mène à rien !

Votre commentaire