Tunisie : l’école publique à bout de souffle
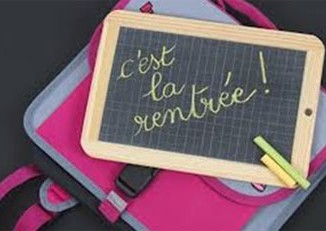
La rentrée 2025 illustre les fragilités persistantes de l’école publique tunisienne. Inégalités régionales, infrastructures vieillissantes et ressources limitées continuent de peser sur le quotidien de millions d’élèves et d’enseignants.
Plus de 2,3 millions d’élèves ont retrouvé, ce lundi 15 septembre, les bancs de l’école, encadrés par quelque 160.000 enseignants du primaire et du secondaire. Pourtant, cette rentrée ressemble aux précédentes : marquée par des promesses de réforme éducative qui se font attendre, mais sans changement profond.
Les maux de l’école tunisienne ne datent pas d’hier et se sont aggravés au fil des ans. Les politiques successives, improvisées ou partielles, ont parfois semblé fragiliser l’école publique et affaiblir sa mission de formation des citoyens.
Lors de l’installation du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement, le président Kaïs Saïed a souligné que la réforme éducative constituait un « chantier national stratégique », appelant à un effort collectif pour moderniser le système et renforcer l’école publique. Malgré cette déclaration, la réalité demeure contrastée : le budget du ministère de l’Éducation en 2025 s’élève à 8.044 millions de dinars, soit une hausse de 8 % par rapport à 2024, mais plus de 90 % de cette enveloppe est absorbée par les salaires. La part du ministère dans le budget global de l’État a, par ailleurs, diminué, passant de 15,9 % en 2010 à 10,3 % en 2025, laissant très peu de moyens pour les infrastructures, la modernisation et la recherche pédagogique.
Un système éducatif inégalitaire
Depuis l’indépendance, la Tunisie a tenté à plusieurs reprises de réformer son système éducatif (1958, 1991 et 2002), avec des résultats mitigés. L’école a souvent servi de « laboratoire », où improvisations et décisions conjoncturelles ont affaibli sa mission : instruire, socialiser et qualifier.
Aujourd’hui, le constat est sans appel : le système éducatif tunisien reste profondément inégalitaire.
Préscolaire : en 2023-2024, seuls 58.064 enfants étaient inscrits dans les écoles publiques. Le taux de couverture national plafonne à 45,6 %, avec un écart flagrant entre Tunis 2 (96,8 %) et Kasserine (44,2 %).
Primaire : le taux moyen de passage est de 91,5 %, variant de 96,7 % à Tunis 2 à 85,3 % à Kasserine.
Baccalauréat 2025 : le taux global de réussite, toutes sessions confondues, s’est établi à 52,59 %, contre 47,41 % de recalés.
Le ministère a publié un classement des directions régionales de l’éducation : en tête, Sfax 1 (71,31 %), suivie de Médenine (68,96 %) et Sfax 2 (68,86 %). En bas du classement : Kairouan (46,28 %), Zaghouan (46,15 %) et Jendouba (43,08 %). Ces écarts traduisent des inégalités structurelles liées aux infrastructures, au nombre d’enseignants qualifiés, à l’accès au transport scolaire et aux services essentiels comme l’eau potable.
Des infrastructures vétustes et des conditions d’apprentissage difficiles
Plus de 500 établissements scolaires dépassent cinquante ans et nécessitent une réhabilitation urgente. De nombreux internats tombent en ruine, tandis que près de la moitié des écoles primaires rurales manquent cruellement d’équipements.
Le paradoxe est frappant : malgré un budget important, plus de 90 % est absorbé par les salaires, laissant peu pour la rénovation, l’entretien et la construction de nouvelles écoles.
Un « mammouth » en quête de réinvention
Le système éducatif tunisien est souvent comparé à un « mammouth » : massif, coûteux et difficile à manœuvrer. Les relations tendues entre le ministère et les syndicats aggravent la situation. Si tous s’accordent sur la crise de l’école, les solutions divergent, et ce blocage chronique empêche toute avancée significative. Pendant ce temps, l’école publique perd de son attractivité, progressivement délaissée par les classes moyennes au profit de l’enseignement privé.
L’école publique, encore un ascenseur social ?
Pendant des décennies, l’école tunisienne a été un puissant levier de mobilité sociale, contribuant à l’émergence d’une classe moyenne instruite et à la modernisation du pays. Mais aujourd’hui, ce rôle est menacé.
Perçue comme « l’école des pauvres », elle peine à remplir sa mission égalitaire et à préparer les jeunes aux défis d’une économie mondialisée, marquée par le numérique, le chômage des diplômés et les mutations technologiques rapides.
La question fondamentale reste : quelle école voulons-nous pour demain ? Une école qui reproduit les inégalités sociales, ou une école qui corrige les fractures territoriales et prépare aux défis du XXIᵉ siècle ?
Une réforme annoncée, mais toujours repoussée
La réforme éducative, annoncée à plusieurs reprises, n’a jamais été mise en œuvre de manière cohérente. Une réforme en profondeur exige plus que des moyens financiers : elle demande un consensus national associant l’État, les syndicats, les enseignants, les parents, les collectivités locales et la société civile. L’éducation doit être pensée comme un projet de société, et non comme un champ de bataille politique.
Si le gouvernement ne prend pas des mesures concrètes rapidement, l’école publique risque de continuer à s’enfoncer dans ses failles, compromettant l’avenir d’une génération entière. L’urgence est de redonner à l’éducation les moyens et la vision qu’elle mérite, sous peine de compromettre le destin du pays.

Votre commentaire